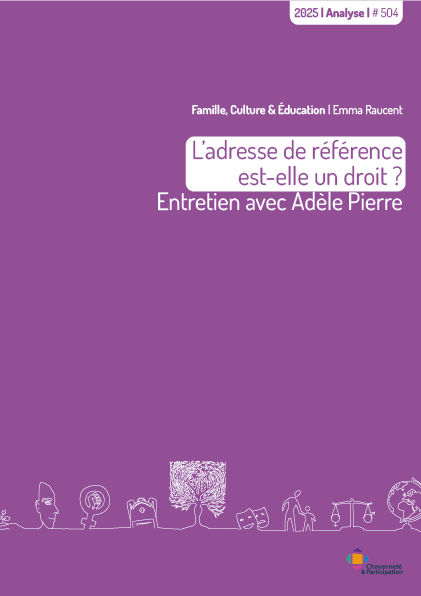
Étude n°52 de Axel Winkel - juillet 2025

Temps de lecture estimé : 35 min
En 2021, la Katholieke Universiteit Leuven (KUL) a lancé le projet « Voordeel van de Twijfel » (« Bénéfice du Doute »). Son objectif : analyser des dossiers de personnes condamnées pour des crimes en Belgique mais qui clament leur innocence derrière les barreaux. Pendant un an, des étudiants en criminologie, en droit ou en sciences biomédicales légales sont invités à étudier un dossier à charge afin d’en vérifier la solidité. Cette initiative s’inscrit dans la lignée d’organisations telles que l’Innocence Project aux États-Unis qui a permis la libération de 251 innocents, dont certains étaient dans le couloir de la mort. Unique dans le paysage belge, le Bénéfice du Doute questionne le « tabou » des erreurs judiciaires en Belgique.
En 2020, nous nous étions déjà intéressés à cette question en interrogeant l’absence d’appel en cour d’assises en Belgique . Pour rappel, en cour d’assises, là où vous êtes accusé des faits les plus graves en droit pénal et où vous risquez les peines les plus lourdes, il n’existe pas de droit à un second procès. Votre seule possibilité est un recours devant la Cour de cassation mais celle-ci ne jugera que de la forme et non du fond. Formellement, le double degré de juridiction est respecté. Mais par rapport à l’esprit des prescriptions internationales dans lesquelles l’appel est bien appuyé comme la garantie d’une justice équitable, le système belge des assises nous paraissait pour le moment insatisfaisant. En ne permettant pas d’appel et en ne proposant que des motivations lapidaires, il affaiblit deux garanties d’une justice équitable et non arbitraire. Et pourtant, les justiciables aux échelons inférieurs y ont droit. On introduit ainsi une discrimination alors même que ces personnes encourent les plus lourdes peines du système pénal belge. Afin de sécuriser encore plus la procédure criminelle pour les justiciables, nous appelions à la création d’une véritable possibilité d’appel pour les arrêts de cour d’assises.
En filigrane de cette analyse se posait donc la question de la possibilité d’erreurs judiciaires au niveau de la cour d’assises en Belgique. Le projet le Bénéfice du Doute permet de rediscuter de cette problématique en ne s’intéressant plus uniquement à « l’architecture » du système judiciaire belge mais aussi au travail de terrain des professionnels de la justice et aux causes reconnues d’erreurs judiciaires. Nous parlerons de faux aveux, de mauvaise gestion de suspects vulnérables, de fausses accusations, de faux en écriture, de recours à des méthodes scientifiques « douteuses », de surcharge de travail… Nous tenterons d’établir la réalité de ces problématiques sur le territoire belge et leurs impacts sur la potentialité d’erreurs judiciaires au niveau de la cour d’assises.
Le projet le Bénéfice du Doute a donc débuté en 2021. Chaque année, il regroupe dix étudiants provenant de criminologie, de droit et de sciences biomédicales légales. Ils réétudient un dossier criminel dans lequel la personne a été condamnée mais clame ou a toujours clamé son innocence. Ils examinent le dossier et identifient les preuves qui s'y trouvent. Ils analysent l'enquête menée par la police, les arguments utilisés par le procureur pour créer le scénario selon lequel cette personne était l'auteur du crime. Ils vérifient si cette approche était valide, si le scénario tient la route, si les bonnes techniques ont été utilisées ou si des erreurs ont peut-être été commises. C’est une nouvelle analyse complète du dossier. Ils ne sont donc pas à la recherche de nouvelles preuves mais se basent uniquement sur le dossier existant lors de la condamnation. À la fin du processus, ils écrivent un rapport. Celui-ci est remis à l’avocat de la personne condamnée ou au condamné lui-même. Dans ce rapport, ils peuvent indiquer de nouvelles pistes qu’il faudrait explorer. Ce rapport peut ensuite être utilisé pour une procédure de révision afin de demander un nouveau procès. Avec un cas par année académique, le programme en est donc à son quatrième dossier mais, tenus par le secret, ils ne peuvent communiquer sur les résultats de leur travail sans autorisation de l’avocat et/ou de la personne condamnée.
Cette initiative unique en Belgique est inspirée par le projet « Gerede Twijfel » (« Doute Raisonnable ») à l’Université libre d’Amsterdam. Créé en 2003, ce projet a mené à la révision de nombreuses affaires criminelles aux Pays-Bas et notamment à la libération en 2022 d’un homme ayant passé quatorze ans en prison pour un meurtre qu’il n’avait pas commis . Les coordinateurs de Gerede Twijfel ont aidé à la création du programme belge. Ces projets comme le Bénéfice du Doute ou le Gerede Twijfel s’inscrivent dans la constellation d’organisations telles que le très connu Innocence Project lancé en 1992 aux États-Unis. Comme indiqué, il a permis la libération de 251 innocents aux États-Unis depuis sa création. Peu à peu, le concept s’est répandu à travers le monde, notamment au Canada, en Italie, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni. Le réseau international Innocence Network a alors été créé en 2005 et il aurait permis la libération de 750 innocents à travers le monde.
Il existe cependant des différences notables entre Gerede Twijfel ou le Bénéfice du Doute et le projet américain. Si aux États-Unis, les étudiants recherchent de nouveaux éléments, de nouvelles preuves et, au final, se rendent au tribunal pour plaider, cela n’est pas le cas en Belgique. Pour Tamara De Beuf, porte-parole et ex-superviseuse du projet à la KUL:
« Ces différences sont entre autres dues au fait que notre projet ne s’étale que sur une année. Si vous voulez plaider au tribunal, c’est un processus qui dure plusieurs années et cela ne correspond pas à notre format » .
Le Bénéfice du Doute est donc moins ambitieux que son organisation « sœur ». Cela est aussi dû à des questions de moyens financiers.
« Il n’y a juste pas de financement et peu d’intérêt pour ce type de projet en Belgique. C’est aussi difficile parce que vous soulignez que les gens font des erreurs ».
Cette question du manque de financement et d’intérêt nous amène à l’épineuse question des erreurs judiciaires en Belgique. Peu présentes dans le débat public, seraient-elles « taboues » ? Pour Tamara De Beuf la réponse est oui. Pour l’illustrer, elle nous parle d’EUREX, un registre européen qui reprend les cas de personnes injustement condamnées pour des crimes et libérées par la suite. Dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, il existe des bases de données qui reprennent les cas de condamnations injustifiées. En Europe, rien. EUREX veut donc combler ce vide afin de mieux comprendre l’étendue du problème à l’échelle européenne. Selon Linda Geven (chercheuse à l’Université de Leiden, à l’initiative du projet),
« On pense souvent que les acquittements de personnes déjà condamnées sont principalement un phénomène américain, mais elles se produisent également régulièrement en Europe. Notre objectif est d’attirer l’attention sur ces condamnations injustifiées et d’en tirer des leçons afin d’éviter qu’elles ne se reproduisent ».
Créé en janvier 2024, EUREX a depuis répertorié 139 condamnations injustifiées pour des crimes dans vingt pays européens. Ces personnes ont passé en moyenne sept ans derrière les barreaux alors qu’elles étaient innocentes. On retrouve notamment des cas en France (10), en Allemagne (33), aux Pays-Bas (15), mais rien en Belgique . Aucun acquittement d’une personne condamnée depuis 1981, date de départ de la base de données. Ainsi, selon cette base de données, en plus de quarante ans et en ce qui concerne les crimes, la Belgique n’aurait commis aucune erreur judiciaire ou en tout cas n’en a reconnu aucune. L’aspect quelque peu « tabou » des erreurs judiciaires en Belgique avait déjà été pointé dans notre précédente analyse. « Nous voulons adresser ce problème et le faire connaitre en Belgique » indique Tamara De Beuf.
Afin d’avoir une compréhension plus précise du phénomène des erreurs judiciaires en cour d’assises en Belgique, nous avons demandé des chiffres à la Cour de cassation sur les révisions en matière pénale. Pour rappel, une révision en matière pénale consiste à demander à la Cour de cassation que votre condamnation soit annulée et revue (voir analyse). En somme, c’est une procédure permettant d’identifier et, si nécessaire, de réparer de potentielles erreurs judiciaires. Dans la révision en matière pénale, il faut par exemple apporter un « fait nouveau » qui met en doute votre culpabilité et justifie ainsi un nouveau procès. Cette procédure a été réformée en 2018 car elle manquait d’impartialité et était trop restrictive. Or, sans possibilité de faire appel d’une décision en cour d’assises et hors erreurs de procédure ou de droit, c’est la seule chance pour un second procès. On a donc élargi la liste des « faits nouveaux » et créé une Commission indépendante qui remet un avis non contraignant à la Cour de cassation.
La révision en matière pénale est donc un indicateur de potentielles erreurs judiciaires dans notre pays. C’est pourquoi nous avons demandé des chiffres à la Cour de cassation. Elle nous a transmis des données sur les procédures en révision entre 1995 et 2025. Sur base de ces celles-ci, on constate qu’au total quatre-vingt-sept dossiers ont été analysés par la Cour de cassation sur cette période. Sur ces quatre-vingt-sept dossiers, douze concernaient des affaires jugées par une cour d’assises. Cependant, au final, aucune de ces condamnations prononcées en cour d’assises n’a été annulée par la Cour de cassation. Dans aucune affaire examinée, la Cour de cassation n’a estimé qu’il y avait une présomption grave que le condamné puisse être innocent et mérite, a minima, un nouvel examen de son dossier par une nouvelle cour. Il n’y a donc eu aucun procès en révision et, en bout de course, aucune erreur judiciaire constatée officiellement en cour d’assises depuis, au moins, 1995. Cela semble corroborer les chiffres d’EUREX. Une réalité que nous confirme également Tamara De Beuf : « À notre connaissance et dans les dernières décennies en Belgique, il n’y a eu aucun procès en révision pour des affaires en cour d’assises en Belgique ».
Pour être précis, sur base des chiffres transmis, cette même cour a malgré tout annulé vingt condamnations sur ces trente dernières années, mais uniquement pour des affaires correctionnelles, de la cour du travail ou encore du tribunal de police. Il convient cependant de rappeler que l’annulation n’est qu’une première étape et qu’elle ne signifie pas un acquittement car une nouvelle condamnation lors du procès en révision est évidemment possible.
Pour en revenir aux condamnations de cour d’assises et au-delà de l’absence officielle de condamnations injustifiées à ce niveau, les données transmises par la Cour de cassation nous montrent aussi que les procédures en révision pour des condamnations en cour d’assises sont extrêmement rares. On parle en effet de douze dossiers analysés par la Cour de cassation en près de trente ans. En moyenne cela représente moins d’un dossier tous les deux ans. À titre de comparaison et sur base des chiffres disponibles, il y aurait eu au total 899 affaires traitées par des cours d’assises en quatorze années, entre 2010 et 2023. Cela représente en moyenne soixante-quatre affaires par an. Si on extrapole grossièrement cette moyenne aux trente dernières années, cela représenterait presque deux mille affaires traitées par des cours d’assises. Même si on ne connait pas le nombre total de condamnations, ces douze procédures en révision au cours des trente dernières années sont anecdotiques comparées aux volumes d’affaires traitées par les cours d’assises en Belgique. C’est donc une procédure rare, exceptionnelle et aux conditions strictes.
À ce niveau et selon Tamara De Beuf,
« les avocats déconseillent d'entamer cette procédure parce qu'ils savent que c'est une procédure très difficile et que les chances d'obtenir une révision et un acquittement sont très, très minces. C'est très coûteux aussi et souvent les condamnés n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour payer cette procédure. Le gouvernement ne fournit aucun financement, par exemple, pour les avocats qui veulent s'occuper des cas de révision. Ces choses sont souvent faites pro bono et elles sont très chères. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les avocats ne sont pas enclins à entamer ces procédures ».
Ces questions financières montrent aussi l’intérêt de projets comme le Bénéfice du Doute afin d’appuyer des demandes en révision de condamnés se disant innocents. En réalité, par leur travail, ils permettent gratuitement la constitution d’un dossier en révision solide. En filigrane, cela pose la question de savoir comment rendre financièrement plus accessible et à large échelle l’introduction d’un dossier en révision à la suite d’une condamnation aux assises pour toute personne se disant innocente.
En 2018, cette procédure en révision a donc été réformée, mais avec quel impact ? On remarque que depuis le début de la nouvelle procédure (1 mars 2019) jusqu’à janvier 2025, la Cour de cassation a entendu dix-neuf affaires contre soixante-huit sur la période présente et sous le régime de l’ancienne procédure (mai 1995 à février 2019). Proportionnellement, la Cour de cassation a donc analysé un peu plus de demandes (en moyenne 3,25 affaires par an sous la nouvelle procédure contre 2,86 affaires par an sous l’ancienne procédure). En ce qui concerne uniquement les affaires de cour d’assises, quatre dossiers ont été reçus sur les cinq dernières années avec la nouvelle procédure contre huit sur les vingt-quatre années précédentes. C’est proportionnellement plus du double (en moyenne 0,33 affaire de cour d’assises par an sous l’ancienne procédure, comparé à 0,68 affaire par an depuis la réforme). Il est possible que, depuis la réforme, les avocats espèrent que la nouvelle procédure soit plus « ouverte » et introduisent ainsi plus de demandes. Cela est positif. Cependant, on manque de recul et on ne peut donc dire avec certitude si cela est réellement dû à la réforme ou au pur hasard vu le nombre extrêmement restreint d’affaires concernées.
Quoiqu’il en soit, cette procédure semble malgré tout rester stricte car, au final, aucune condamnation en cour d’assises n’a été annulée par la Cour de cassation. Une procédure en révision a par exemple récemment été introduite dans une affaire de meurtre, en y incluant notamment le travail de la KUL et de Gerede Twijfel sur cette affaire . Elle a finalement encore été jugée non fondée par la Cour de cassation . Comme indiqué dans notre précédente analyse , malgré la réforme, cette procédure se doit théoriquement de rester exigeante. En effet, à un moment donné, il faut pouvoir s’accorder sur une vérité judiciaire et éviter que les procès ne se rejouent ad vitam aeternam. C’est pourquoi les conditions sont très strictes. Si ce raisonnement tient la route par exemple pour les jugements en correctionnelle où l’appel est possible, cela pose plus de questions pour les assises. Sans possibilité d’appel et sauf erreur de procédure, la révision est la seule chance pour qu’on discute du fond une seconde fois.
Même si on note potentiellement une très légère « ouverture » théorique depuis la réforme, ces données nous confirment que la procédure en révision reste stricte et exceptionnelle. La probabilité qu’une affaire d’assises soit entendue par la Cour de cassation est extrêmement faible. Ces données nous informent également qu’aucun procès en révision pour une affaire de cour d’assises n’a eu lieu depuis 1995. Il n’y a donc eu officiellement aucune erreur à ce niveau sur les trente dernières années. Comment comprendre cette situation ? Cela signifie-t-il que notre système judiciaire au niveau de la cour d’assises fonctionne parfaitement, sans aucun faux pas ? Plus précisément, la Belgique serait-elle immunisée contre les causes reconnues d’erreurs judiciaires à l’international ? C’est ce que nous allons tenter d’explorer lors des prochains chapitres.
Même si on note potentiellement une très légère « ouverture » théorique depuis la réforme, ces données nous confirment que la procédure en révision reste stricte et exceptionnelle. La probabilité qu’une affaire d’assises soit entendue par la Cour de cassation est extrêmement faible. Ces données nous informent également qu’aucun procès en révision pour une affaire de cour d’assises n’a eu lieu depuis 1995. Il n’y a donc eu officiellement aucune erreur à ce niveau sur les trente dernières années. Comment comprendre cette situation ? Cela signifie-t-il que notre système judiciaire au niveau de la cour d’assises fonctionne parfaitement, sans aucun faux pas ? Plus précisément, la Belgique serait-elle immunisée contre les causes reconnues d’erreurs judiciaires à l’international ? C’est ce que nous allons tenter d’explorer lors des prochains chapitres.
Pour commencer à explorer cette question des causes reconnues d’erreurs judiciaires, EUREX a pointé que 30 % des condamnations injustifiées pour crimes recensées en Europe étaient dues à des faux aveux. Qu’en est-il de ce phénomène en Belgique ? Pour l’illustrer, on peut explorer l’affaire Carlo V. qui a beaucoup fait parler d’elle en Flandre. En 2011, ce jeune homme de vingt-et-un ans est interrogé pour un meurtre survenu en 2009. Au bout de plusieurs interrogatoires, il avouera le meurtre. Il est incarcéré en attente de son procès à Termonde qui aura finalement lieu en 2020. Et là, toute l’accusation s’écroule. Les interrogatoires étaient filmés. On se rend compte qu’ils ont été longs, de nuit. Ses avocats ne sont jamais présents. Surtout, Carlo V. est déficient mental. Il a un QI de 66, équivalent à celui d’un enfant de dix ans. Les enquêteurs le savent mais ne le prennent pas en compte. Ils lui mettent la pression. Carlo V. indique à ses avocats qu’il essaie surtout de donner « les bonnes réponses » et raconte « ce qu'on attend de lui ». Selon les avocats de Carlo V., on lui a aussi promis à manger s’il avouait. À la fin du dernier interrogatoire, quand le policier lui demande de confirmer qu’il dit la vérité, Carlo V. lui répond : « J’essaie juste de vous aider les gars ». Le juge a finalement estimé que les enquêteurs avaient exercé une pression illicite sur Carlo V., ce qui l’a mené à de faux aveux. Vu qu’aucune autre preuve ne le liait au crime, Carlo V. est enfin libéré. Il aura donc passé neuf ans en prison alors qu’il était innocent. Cette affaire n’est pas reprise dans la base de données EUREX car au final Carlo V. n’aura jamais été condamné.
Nous avons ici un cas évident de faux aveux et de mauvaise gestion de suspects vulnérables qui aurait pu mener à une condamnation injustifiée. Mais ce n’est malheureusement pas un cas isolé. En 2011, Geert V. est arrêté pour le meurtre de sa compagne, Caroline V.. Il avoue le meurtre. Mais lors de son procès aux assises en 2015, il sera finalement disculpé. Le véritable coupable était un voisin chez qui on a retrouvé des morceaux du corps de Caroline V. ainsi que son portable et un couteau avec des traces ADN de la victime. Geert V. était aussi déficient mental et aurait avoué sous la contrainte et à nouveau sans la présence d’un avocat. Il aura passé injustement plus de quatre années en prison dans l'attente de son procès.
Pour continuer sur les sources d’erreurs judiciaires identifiées sur le territoire belge, il faut revenir à l’affaire Carlo V. Dans ce dossier, il est important de noter qu’un enquêteur ayant participé à l’affaire a par la suite été condamné pour faux en écriture. En effet, il n’avait pas consigné dans son procès-verbal une conversation qu’il avait eue avec le suspect et où il le poussait à avouer. Malheureusement pour le policier, cette conversation a été enregistrée. Le tribunal a considéré cet « oubli » comme une altération de la vérité et indique que « l'accusé s'est certainement révélé être un enquêteur peu fiable qui […] avait apparemment supposé que la fin justifiait les moyens ». Justement, selon EUREX, « les fonctionnaires de police peuvent commettre une faute professionnelle […] due à un phénomène connu sous le nom de « vision tunnel ». Ce phénomène se produit lorsque, par exemple, un policier est excessivement convaincu de la culpabilité de son principal suspect, ce qui l'amène à se concentrer uniquement sur les éléments de preuve qui confirment cette conviction ». Dans l’affaire Geert V., deux policiers ont aussi été poursuivis pour faux en écriture. Mais ils ont été relâchés en raison du dépassement du délai raisonnable. Selon EUREX, les fautes professionnelles sont, tout comme aux États-Unis, une autre cause reconnue d’erreurs judiciaires en Europe.
Pour Tamara De Beuf, « ces affaires prouvent que les causes reconnues d’erreurs judiciaires, telles que les faux aveux, existent aussi en Belgique. Ce ne sont pas que des phénomènes nord-américains. Dans ces cas-ci, cela a heureusement été constaté par le juge. Mais si vous n'avez pas une bonne équipe d’avocats, ou si vous avez un juge qui n'est pas conscient par exemple du risque de faux aveux, alors il est possible que cela se perde dans les dédales du système judiciaire et que les gens puissent être condamnés ».
Des causes reconnues d’erreurs judiciaires telles que les faux aveux ou la mauvaise gestion de suspects vulnérables existent donc bel et bien sur le territoire belge. En ce qui concerne la potentialité que cela puisse ne pas être identifié par les juges et mener à une condamnation injustifiée, une étude s’est penchée sur le processus de décision des juges en Belgique et la manière dont ils évaluent les aveux ou déclarations des suspects. Les conclusions ne sont pas spécialement rassurantes. Dans les grandes lignes, les juges se questionneraient très peu sur la manière dont des aveux ou déclarations ont été obtenus. Cela ne serait pas un aspect essentiel dans l'évaluation des preuves. Surtout si les aveux semblent « bons », c’est-à-dire en cohérence avec d’autres preuves (sans juger de l’exactitude/crédibilité de ces autres preuves). De manière générale, les juges considèrent le risque de faux aveux assez faible et ils ne s’intéresseraient à la manière dont des déclarations ont été obtenues que si les avocats du suspect soulèvent cette question ou si les déclarations/aveux sont en contradiction avec d’autres éléments. Ils jugeraient par contre les dénégations plus suspectes et passeraient plus de temps à tenter de les réfuter que les aveux. Au final, ces conclusions soulignent un risque réel pour que des cas de faux aveux, mauvaise gestion de suspects vulnérables ou fautes professionnelles comme évoqués ci-dessus, puissent ou aient pu mener à des condamnations injustifiées sur le territoire belge.
On a vu dans les affaires précédentes que les suspects n’ont pas toujours eu accès à un avocat lors des interrogatoires. Cela pourrait surprendre. En effet, et à titre de vulgarisation, dans les séries américaines, on voit souvent les policiers répéter leurs droits au suspect, notamment celui d’être assisté par un avocat. C’est ce qu’on appelle les droits Miranda. À ce niveau, il faut savoir que jusqu’en 2012, il n’était en réalité pas obligatoire en Belgique que vous soyez assisté par un avocat lors de votre audition par la police. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Salduz C. Turquie) a estimé que cela contrevenait au droit à un procès équitable. C’est pourquoi la loi Salduz a vu le jour en 2012. Plusieurs fois modifiée depuis sa création, elle garantit que toute personne privée de liberté ou suspectée d’une infraction passible d’une peine de prison d’un an ou plus a droit à l’assistance d’un avocat pendant son audition. Cette personne a aussi le droit à un entretien confidentiel avec son avocat avant l’audition. S’il est majeur, le suspect peut renoncer à ce droit par écrit. Ces règles datant de 2012, l’absence d’avocats lors des interrogatoires de Carlo V. (2011) ne contrevenait donc pas à la loi même si leur présence aurait été plus que bénéfique.
Malgré cette loi, ces droits ne sont malheureusement pas toujours respectés. En 2018, la Belgique est condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Beuze au cours de laquelle le suspect d’un crime n’a pas eu droit à l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue. Par la suite, on a jugé que l’accès à son avocat a été fortement restreint pendant toute l’instruction. En 2021, la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la Belgique au motif qu’elle n’aurait pas « transposé correctement les règles de l'UE relatives à l'accès à un avocat ». Dans le viseur de la Commission, il y avait notamment le délai de deux heures d’attente après lequel l’audition pouvait commencer même si l’avocat n’était pas encore présent. Pour la Commission, le fait que le « juge d’instruction puisse faire débuter l’audition même si l’avocat n’est pas encore présent est contraire aux dispositions de la directive, qui ne prévoit pas cette exception possible au droit à l’accès à un avocat ». Il faudra finalement attendre 2024, après que la Commission ait saisi la Cour de justice de l'Union européenne, pour que la Belgique adapte enfin sa législation.
En ce qui concerne le droit prévu par la loi Salduz à un entretien confidentiel avec son avocat avant l’audition, un scandale a éclaté en 2021 révélant qu’une zone de police écoutait et filmait ces entretiens entre avocat et suspect. Cette problématique a alors été soulignée de manière plus large dans un rapport de l’Organe de contrôle de l’information policière où il a été constaté que près d’un quart des entités de police interrogées disposaient de caméras de surveillance dans les salles de concertation confidentielles. Le rapport souligne aussi qu’un « nombre relativement important d’entités de police ne connaissent/comprennent pas entièrement les aspects juridiques potentiels (complexes) qui sont importants pour la décision de recourir à la surveillance par caméra et/ou à un système audiovisuel pendant la concertation confidentielle, et ne les prennent dès lors pas en considération ».
EUREX ne dispose pas de chiffres sur cette thématique à l’échelle européenne, mais pointe qu’aux États-Unis le fait de se voir refuser une assistance juridique appropriée contribue entre 7 à 27 % des condamnations injustifiées. La question de l’accès à un avocat et les droits de la défense semblent ainsi essentiels quand on vient à parler de potentielles erreurs judiciaires. Il est donc important de noter que l’accès à un avocat lors de l’audition par la police, en tant que garantie du droit fondamental à un procès équitable, n’était pas une obligation en Belgique jusque 2012. Cela pose évidemment des questions sur l’impact que cette « absence » a pu avoir sur des condamnations passées, surtout en ce qui concerne des suspects vulnérables. Cette loi et les modifications ultérieures sont en tout cas positives et offrent aujourd’hui plus de garanties des droits de la défense. Cependant, vu les manquements récents, cela reste un point d’attention en ce qui concerne le « potentiel » d’erreurs judiciaires en Belgique.
Quand on parle d’erreurs judiciaires, il est important de s’intéresser aux techniques utilisées par la police. À ce niveau, il faut savoir que la Belgique est un des rares pays en Europe à avoir recours au polygraphe (ou détecteur de mensonges). Surtout à une telle ampleur. En effet, la police belge utiliserait le polygraphe plus ou moins 500 fois par an, ce qui est considérable. Il serait principalement utilisé dans des dossiers de violences sexuelles (70 %) et dans des affaires d’homicides (20 %). Nous avons une véritable tradition belge du polygraphe depuis plus de vingt ans. Pourtant, il a fallu attendre 2020 pour que l’utilisation du polygraphe soit encadrée par une loi. Celle-ci visait à uniformiser l’application du test, la procédure à suivre et déterminer les personnes qui peuvent y être soumises. On y indique aussi que le polygraphe ne peut être utilisé que comme preuve corroborant d’autres moyens de preuves. À eux seuls, les résultats d’un test de polygraphe ne peuvent mener à une condamnation.
On peut quand même se poser la question de l’utilisation d’un tel instrument dans les procédures criminelles. Bertrand Renard (Institut national de criminalistique et de criminologie) indiquait : « le polygraphe a été utilisé des milliers de fois en Belgique sans qu’on n’ait jamais fait une évaluation scientifique de son usage. C’est d’autant plus important qu’il est utilisé dans des affaires graves, avec atteintes à la personne, décès ou viol, donc des affaires qui peuvent entraîner de lourdes condamnations ». Il poursuit : « Le polygraphe ne fait donc pas l’unanimité. La Belgique est l’un des seuls pays à l’utiliser et d’autres pays l’ont rejeté comme la France ou les Pays-Bas qui ont décidé de ne pas y avoir recours suite à des analyses scientifiques ». Pour Vanessa Codaccioni (professeure au département de science politique de l’Université Paris 8, spécialiste de la justice pénale et de la répression), « ces détecteurs de mensonges sont en réalité des détecteurs de stress. Or rien ne permet aujourd’hui de prouver que quelqu’un qui est stressé ment. […] Lors d’un interrogatoire, plusieurs facteurs peuvent générer des manifestations liées au stress : l’attitude menaçante de la personne qui mène l’interrogatoire, mais aussi une rage de dents, une chaleur excessive, ou bien la peur d’être discriminé parce qu’on est une femme ou parce qu’on est un noir face à un policier blanc. Ces facteurs de stress peuvent générer de faux positifs ». L’ordre des barreaux flamands, opposé au polygraphe, abonde dans le même sens : « les résultats ne sont pas fiables, l'appareil ne détectant pas les mensonges, mais enregistrant uniquement certaines réactions physiques lorsqu'un suspect répond ».
En prenant en compte ces points d’attention, le polygraphe ne peut donc normalement servir que comme preuve corroborant d’autres moyens de preuve. Mais il est notamment utilisé dans des affaires où il y a justement peu de preuves, des situations de parole contre parole. Dans ces cas, il est probable que le polygraphe puisse avoir une plus forte influence alors même que sa fiabilité est régulièrement remise en cause. Pour Bertrand Renard « l’usage du polygraphe dans un contexte de cour d’assises reste un point noir ». Les jurés pourraient être impressionnés, influencés par l’aspect supposément scientifique de cet outil. Aussi, même si un suspect peut refuser de passer le test sans que cela ait de conséquence juridique, dans la réalité « le risque est que les jurés considèrent ce refus comme suspect en soi ».
EUREX note qu’un grand nombre d’erreurs judiciaires sont aussi dues à des preuves médico-légales fausses ou trompeuses. Ils pointent que « cela comprend également les preuves obtenues par une technique médico-légale qui n'a pas été testée pour établir sa fiabilité et sa validité, ou des techniques qui se sont avérées non fiables. Avec l'avènement de la technologie de l'ADN, de nombreuses techniques que les tribunaux considéraient comme fiables (par exemple, les analyses capillaires microscopiques) ont été discréditées en tant que “pseudo-science” ». Le polygraphe n’est peut-être pas une « preuve médico-légale » en tant que telle mais ces réserves quant aux dangers des « pseudo-sciences », des techniques non validées dans le cas d’erreurs judiciaires s’y appliquent très concrètement. EUREX pointe aussi que ces preuves peuvent « tromper » les juges et jurés. « Les recherches indiquent que les praticiens du droit sont souvent insuffisamment conscients de l'ambiguïté et de la subjectivité de certaines preuves scientifiques médico-légales ». À nouveau, même si le polygraphe ne peut être utilisé comme preuve unique, on peut clairement se poser la question de son impact sur des juges ou jurés pas suffisamment conscients des limites de cette « science ». L’utilisation massive du polygraphe en Belgique est donc un autre point d’attention non négligeable en termes de risques d’erreurs judiciaires.
Comme nous l’avions indiqué, la KUL ne communique pas sur les dossiers sur lesquels ils travaillent. Mais récemment l’affaire Daniël F. a émergé dans la presse. Nous pouvons donc en parler afin d’illustrer plus concrètement le travail réalisé par le Bénéfice du Doute ainsi que les facteurs potentiels d’erreurs sur le territoire belge.
En 2020, Daniël F. a été condamné à vingt-huit ans de prison pour le meurtre afin de faciliter le vol de Léopoldine D.. Trois autres personnes sont condamnées : Branko S. (co-auteur du meurtre et du vol) ainsi que Guus W. et Pieter V. en tant que commanditaires du vol qui a mal tourné. Au travers du De Morgen, on apprend que le Bénéfice du Doute a étudié ce dossier et que leurs conclusions sont que Daniël F. n’aurait jamais dû être condamné.
L’accusation à l’encontre de Daniël F. reposait sur deux éléments : la mise en cause de ce dernier par Pieter V. (le commanditaire) ainsi que des images de vidéosurveillances où l’on voit deux hommes de dos à proximité du domicile de la victime et de l’heure du crime. Selon l’accusation, un de ces « dos » correspondrait à celui de Daniël F.. Cependant, l’équipe du Bénéfice du Doute remet en cause certains éléments. Tout d’abord, l’heure de la mort de Léopoldine D. Celle-ci avait été estimée entre 22h30 et 23h30. Les deux « dos » ayant été filmés aux alentours de 20h30, cela permettait de les lier au crime. Mais selon le Bénéfice du Doute, l’heure de la mort se situerait en réalité entre 00h30 et 6h30 du matin. Les images de vidéosurveillance de ces deux « dos » n’auraient donc plus de liens directs et évidents avec les faits. Les propos du principal accusateur (Pieter V.) seraient aussi à prendre avec des pincettes car il indique que Branko S. et Daniël F. se seraient rendus à son café après le crime, vers 22h00. Or, sur base des analyses du Bénéfice du Doute, Léopoldine D. était toujours vivante à ce moment-là. Toujours en ce qui concerne les accusations de Pieter V., l’équipe de la KUL remet en cause l’utilisation d’un détecteur de mensonges comme preuve de l’honnêteté de ses déclarations. Le polygraphe qui est, comme on l’a vu, un outil dont la fiabilité est scientifiquement fortement contestée.
Enfin, il y a l’alibi de Daniël F. qui aurait été mal vérifié par la police, sans que l’on sache si cela était intentionnel ou non. En effet, Daniël F. a toujours indiqué avoir visité des biens à louer avec sa mère le soir du crime. Des échanges de mails ont confirmé cette information. Les personnes présentes lors des visites également. Mais lorsque la police a voulu vérifier l’alibi, elle n’a montré que des photos de la mère à ces témoins et non pas de Daniël, ce qui a empêché de le disculper formellement.
Sur base de tous ces éléments, l’équipe de la KUL conclut ceci : « Les seuls éléments de preuve qui vont effectivement en direction de Daniël F. sont les images de la caméra et les déclarations de Pieter V. Par conséquent, à notre avis, il n'y a pas de certitude humaine que Daniël F. est coupable du meurtre. L'arbitrage dans ce cas pèse plutôt en faveur du doute ». Le Bénéfice du Doute ne dit donc pas que Daniël F. est obligatoirement innocent mais que les éléments à charge sont trop faibles et incertains pour conduire à une condamnation. Tamara De Beuf nous confirme que « sur la base des éléments de preuve présentés dans cette affaire, cette personne n'aurait pas dû être condamnée. Le rapport ne fait aucune déclaration sur l’innocence ou la culpabilité ».
Pour information, avant que le Bénéfice du Doute n’étudie son cas, Daniël F. avait déjà effectué un recours en révision en 2022. Les faits « nouveaux » consistaient notamment en un enregistrement audio d’un des coaccusés qui indique que Daniël est innocent. Mais, sans surprise sur base des chiffres évoqués au début de cette étude, ce recours n’a pas été accepté.
En conclusion, cette fuite dans la presse permet d’apprécier plus pratiquement le travail effectué au sein de ce projet ainsi que son intérêt. Ils questionnent le travail d’enquête de la police (notamment la vérification inadéquate de l’alibi de Daniël F. ou la question de la faute professionnelle), l’exactitude des preuves médico-légales (l’estimation de l’heure de la mort de Lépoldine D.) ainsi que le recours à une technique controversée, le polygraphe. Ce faisant, ils dressent un tout autre scénario qui questionne la culpabilité de Daniël F. hors de tout doute raisonnable. Au-delà des fautes professionnelles ou des preuves médico-légales fausses ou trompeuses, l’équipe du Bénéfice du Doute interroge en filigrane une autre source reconnue d’erreurs judiciaires : les parjures ou fausses accusations. Sur base des données d’EUREX, les fausses accusations seraient, après les faux aveux, la deuxième cause des erreurs judiciaires recensées. Dans ce cas précis, on ne peut conclure avec certitude que Pieter V. a menti. Mais des éléments mettent en question ses propos. Une potentielle fausse accusation avait aussi été mise en cause dans la fameuse affaire de frères Gottschalk (voir analyse) qui avait été pointée par le Conseil supérieur de la Justice comme une potentielle erreur judiciaire et avait mené à la réforme de la procédure de révision des procès en matière pénale en Belgique. Cette même problématique avait été au cœur de l’emblématique naufrage judiciaire de l’affaire d’Outreau en France (voir analyse). Dans cette sordide histoire, c’était l’existence d’un appel aux assises qui avait permis de mettre à jour cette fausse accusation et de libérer les innocents. Un appel salvateur mais qui est, on le répète, inexistant en Belgique.
En somme, si, comme on l’a vu, il n’y a pas eu officiellement de condamnation injustifiée en cour d’assises lors des dernières décennies, on ne peut pourtant pas affirmer que la Belgique est immunisée contre les causes reconnues d’erreurs judiciaires. On a parlé de cas concrets de faux aveux, de mauvaise gestion de suspects vulnérables et de fautes professionnelles. Si dans les affaires étudiées, ces erreurs ont heureusement finalement été détectées, l’étude sur la manière dont les juges belges évaluent les aveux ou déclarations des suspects doit éveiller notre attention et nous montre qu’il n’est pas possible de garantir que des erreurs similaires aient pu ou puissent passer à travers les mailles du filet et mener à des condamnations injustifiées. Les droits de la défense récemment élargis mais pas toujours respectés ainsi que le recours massif à une technique aussi controversée que le polygraphe dans les affaires criminelles finissent d’ancrer les causes reconnues d’erreurs judiciaires sur le territoire belge et, a minima, nous amènent à sérieusement questionner cette absence officielle d’erreurs judiciaires en cour d’assises.
Nous avions parlé du « dilemme de l’innocent » en ce qui concerne la libération conditionnelle dans notre précédente analyse (voir analyse). Comme les frères Gottschalk, Daniël F. est à nouveau confronté à ce problème. Il pourrait bientôt demander une libération conditionnelle. Malheureusement pour lui, une condition pour la libération conditionnelle est notamment « l’attitude du condamné à l’égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation ». Mais il clame toujours son innocence. Comme on l’avait indiqué, en clamant « son innocence, on ne reconnaît donc pas sa responsabilité, on ne présente peut-être pas non plus d’excuses aux victimes car on se considère innocent. On ne les indemnise pas non plus. Cette absence de mea culpa peut donc constituer une contre-indication empêchant une libération conditionnelle ». Daniël F. se retrouve donc à nouveau face au même dilemme que les frères Gottschalk : reconnaitre sa culpabilité et sa responsabilité pour bénéficier de la libération conditionnelle ou continuer à clamer son innocence au risque d’aller à fond de peine au vu de la complexité des procédures en révision ?
Avant de passer aux conclusions, il est important de parler d’un autre objectif du projet le « Bénéfice du Doute » : éduquer les acteurs du système judiciaire aux facteurs qui peuvent conduire aux erreurs judiciaires. Les étudiants qui passent par le projet sont évidemment sensibilisés à cette problématique. « Nous voulons leur apprendre à être critiques à l'égard d'une enquête médico-légale ou à l'égard de ce qu'ils lisent et voient dans un tel rapport. Et à être conscients qu'il existe des condamnations injustifiées, afin qu'ils puissent utiliser ces connaissances lorsqu'ils quitteront la KUL et qu'ils entreront dans le monde du travail ». C’est une autre manière de briser le « tabou ». Au-delà des quelques étudiants qui suivent le programme et « sur la base des connaissances acquises dans d'autres pays, il est important d'informer toutes les personnes impliquées dans le système de justice pénale sur ces facteurs de risque. Nous savons donc que les faux aveux existent. Nous ne les voyons pas seulement aux États-Unis. Il est donc important d'informer les juges, les avocats et les membres de la police sur les faux aveux et les facteurs qui y contribuent, comme la vulnérabilité des suspects. Il y a beaucoup de choses sous-jacentes. Les préjugés ont aussi un impact et mènent à une « vision tunnel ». Nous pouvons contribuer à sensibiliser les professionnels au risque de partialité, au risque de faux aveux ».
Cela est d’autant plus important dans un système judiciaire structurellement sous-financé. « Nous constatons également que ces professionnels et le système judiciaire sont soumis à une forte pression. Ils ont une énorme charge de travail, ce qui peut également augmenter les risques d'erreurs ». Une enquête du Collège des cours et tribunaux a montré que les juges travaillaient en moyenne 52,8 heures par semaine. Ils sont donc surchargés et effectuent énormément d’heures supplémentaires. Il faudrait augmenter de 43 % le nombre de juges pour que ceux-ci puissent effectuer des temps pleins normaux. Pour le Collège des cours et tribunaux, « la charge de travail est insoutenable ». En 2016, face au manque criant d’investissement dans la justice en Belgique, le premier président de la Cour de cassation de Belgique Chevalier de Codt disait même : « Cet État n'est plus un État de droit, mais un État voyou ». Un constat préoccupant quand on vient à parler de risque d’erreurs judiciaires.
Selon la théorie du processus dual de raisonnement issue de la psychologie cognitive, nous avons deux systèmes de raisonnement. Le premier nous permet de penser rapidement et de privilégier la pensée intuitive. Le deuxième est un processus plus coûteux, plus calculé et contrôlé qui nous permet de réfléchir plus consciemment aux décisions que nous prenons. Pour Tamara De Beuf, « les personnes sous pression, avec une lourde charge de travail et des contraintes de temps, choisissent davantage le premier système de raisonnement. C'est-à-dire la pensée rapide, la pensée plus intuitive ». Le revers de la médaille est que ce mode de raisonnement est plus susceptible d’être influencé par des biais cognitifs et sociaux. Si la pensée intuitive est très utile dans la vie quotidienne et nous permet, par exemple, de ne pas devoir réfléchir consciemment à chaque pas que nous faisons, « dans le cas de décisions importantes, par exemple dans un tribunal, elle peut laisser plus de place aux partis pris, aux préjugés ou à une « vision tunnel ». En ce sens, d'après la psychologie, on s'attend à ce que les personnes surchargées de travail et soumises à une forte pression commettent davantage d'erreurs. Ils se fient davantage à leur pensée intuitive. Ce qui, à un stade ultérieur de la procédure, peut aboutir, dans le pire des cas, à une condamnation injustifiée ».
On l’a vu, la Belgique n’est pas immunisée contre les causes reconnues d’erreurs judiciaires. Les affaires Carlo V. ou Geert V. ont clairement souligné l’existence des faux aveux et la mauvaise gestion de suspects vulnérables. L’affaire Daniël F., et avant lui l’affaire des frères Gottschalk, ont questionné la problématique des fausses accusations. À eux seuls, ces deux éléments représentent plus de la moitié des erreurs judiciaires recensées par EUREX. Des fautes professionnelles de fonctionnaires de police ont aussi été pointées dans l’affaire Carlo V. mais aussi celle de Geert V. La Belgique a également recours massivement aux « détecteurs de mensonges » dans les affaires criminelles, une technique considérée par beaucoup comme de la pseudoscience. Or l’utilisation de preuves scientifiques trompeuses est une autre cause reconnue d’erreurs judiciaires. Enfin, il y a le droit d’accès à un avocat lors de l’audition par la police qui a été longtemps restreint et maintenant élargi mais malheureusement pas toujours respecté. À cela, il faut ajouter un système judiciaire au bord de l’épuisement marqué par une charge de travail excessive pour les juges et l’ensemble de l’institution judiciaire. Une réalité elle-même susceptible de causer des erreurs.
De prime abord, ce constat ne devrait pas nous étonner. Tout système judiciaire est marqué par des lignes de tension, des errements. La Belgique et sa justice ne font pas exception. Ce qui est plus étonnant, ou inquiétant, c’est cette forme de « tabou » qui entoure les condamnations injustifiées, surtout au niveau de la cour d’assises. Comme on l’a dit, EUREX n’a pas été à même de recenser en Belgique un seul acquittement après une condamnation pour un crime depuis 1981. A minima, les chiffres transmis par la Cour de cassation révèlent qu’il n’y a eu aucun procès en révision pour des condamnations en cour d’assises, et donc aucune erreur judiciaire officiellement reconnue, depuis 1995 (date de début des données transmises). Alors même que chez tous nos voisins (France, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni), plusieurs cas ont été clairement identifiés et étudiés. Ces cas ont été médiatisés et sont maintenant une donnée du débat public. Il y est admis que la justice est capable d’erreurs. Ce qui est positif et sain dans une société démocratique. En Belgique, rien depuis des décennies. Pouvez-vous citer une seule affaire emblématique où une personne a été condamnée pour un crime en cour d’assises et a par la suite été innocentée ? Sur base des chiffres étudiés, la réponse la plus probable est non. À elle seule, cette réponse par la négative devrait éveiller notre attention. Surtout si l’on couple cela au système belge sans possibilité d’appel pour les assises.
C’est là que se trouvent tout l’intérêt et l’importance d’un projet comme le Bénéfice du Doute. Par leur travail, ils tentent de mettre au cœur du débat public la question des condamnations injustifiées. Ils attirent l’attention sur les causes reconnues d’erreurs judiciaires et leur réalité sur le territoire belge. Des suspects vulnérables poussés abusivement aux aveux pour boucler une affaire, cela existe en Belgique. Des policiers « véreux » coupables de faux pour soutenir leur thèse du coupable idéal ou l’utilisation de procédés pseudoscientifiques, cela existe aussi. Ce ne sont pas que des phénomènes nord-américains dont on se gave sur les plateformes de streaming. Ils ne sont pas étrangers à notre pays et il est nécessaire d’en parler. Cette simple reconnaissance est un premier pas positif. Mais si on fait le constat que ces errements existent en Belgique, la suite logique devrait être que des personnes ont déjà été injustement condamnées pour des crimes. La suite logique devrait être que des personnes sont actuellement injustement dans nos prisons pour de longues peines.
Au-delà de la sensibilisation, c’est là le cœur du travail du Bénéfice du Doute : permettre d’aider et de libérer des innocents. Le projet est jeune et seulement trois dossiers ont pu être analysés. Il faudra aussi voir quelles suites sont données à l’affaire Daniël F. Quoi qu’il en soit, l’objectif est juste et légitime, mais les moyens sont limités. Comme on l’a dit, le projet est moins ambitieux que l’Innocence Project. Les étudiants n’ont pas le temps de se mettre à la recherche de nouvelles preuves et ne peuvent aller plaider au tribunal. Pour cela, il faudra plus d’investissements pour construire un projet sur le long cours permettant ces démarches. Il serait aussi intéressant de réfléchir à un projet à l’envergure nationale avec la collaboration d’universités francophones. Pour Tamara De Beuf, « il est tout simplement important que nous fassions quelque chose à ce sujet en Belgique. La meilleure chose à faire serait de s'associer à des professionnels et à des universités, y compris les universités francophones, pour créer un projet Innocence en Belgique qui impliquerait également d’aller au tribunal et de plaider. J'espère vraiment qu'à l'avenir, nous y arriverons ».
Sur base des constats de ce papier et de notre analyse précédente sur le sujet, nous ne pouvons que soutenir cette initiative et appeler également à la création d’un Projet Innocence en Belgique. Nous tenons aussi à réitérer notre revendication pour la création de la possibilité d’un véritable appel pour les arrêts de cours d’assises. Cet appel est nécessaire pour garantir une justice plus équitable et offrir une meilleure sécurité juridique aux justiciables. En 2021, la Ligue des Droits Humains faisait le même constat que nous : « Il n’est en outre pas admissible, tant « juridiquement et au plan même de l’éthique », de maintenir une discrimination entre les personnes poursuivies devant les tribunaux correctionnels ou de police et les accusé·e·s en cours d’assises, susceptibles d’encourir des peines les plus sévères et démuni·e·s de la possibilité de former appel : il n’est pas tenable que les droits des un·e·s restent amoindris en comparaison de ceux qui profitent aux autres poursuivi·e·s devant les juridictions ordinaires. […] Il est donc incontournable qu’une procédure d’appel des décisions rendues par les cours d’assises soit instituée par le législateur ». Cela est d’autant plus incontournable que, comme on l’a vu, une fois condamné en cour d’assises, les probabilités que votre dossier soit entendu par la Cour de cassation dans le cadre d’une procédure en révision sont infinitésimales (douze dossiers sur les trente dernières années) et les chances d’obtenir une annulation de votre condamnation et un procès en révision sont quant à elles proches ou équivalentes à zéro (aucun procès en révision en Belgique depuis au moins 1995).
Au-delà de l’absence d’appel, l’utilisation du polygraphe nous pose aussi de grosses questions, surtout dans le contexte des assises. On l’a vu, une loi a récemment encadré son utilisation. On peut considérer cela comme un point positif. Mais ce faisant, on fait rentrer officiellement le polygraphe dans le Code d’instruction criminelle et on lui confère une plus grande légitimité. Maître Raphael Koning, qui a été auditionné en tant que représentant d’Avocats.be par la commission justice de la Chambre sur la proposition de loi en ce qui concerne l’utilisation du polygraphe, indiquait ainsi : « AVOCATS.BE s’interroge sur l’opportunité d’inscrire dans le Code d’instruction criminelle l’usage du polygraphe au titre de méthode d’investigation légalement reconnue étant donné la validation intrinsèque que cela lui confèrera dans l’esprit des autorités judiciaires et policières, et de l’opinion publique. La tentation pourrait être en effet très grande chez d’aucuns parmi les magistrats de l’enquête ou des cours et tribunaux ainsi que dans les médias qui forgent l’opinion publique, de s’en remettre trop aisément à cette technologie, leur apportant en effet le confort intellectuel de l’infaillibilité alléguée de la science « d’être couvert », justifiant de ne pas/plus se poser de questions ». Il insiste sur le manque de fiabilité de cette technologie « pour permettre de condamner son prochain avec la certitude de ne pas condamner un innocent » et rappelle l’historique de ces « techniques » de détection du mensonge : « Au Moyen-Âge déjà, les juges faisaient ingurgiter de la farine aux suspects pour identifier ceux dont la bouche s'asséchait, censés être des menteurs… ! ». La Belgique est un des rares pays européens à utiliser cette « science » si controversée dans ses procédures criminelles. Cela est inquiétant quand on vient à parler du risque d’erreurs judiciaires. Surtout dans un contexte d’assises marqué par des motivations lapidaires (qui doivent expliquer le pourquoi de la condamnation), l’absence d’appel (hors pourvoi en cassation qui ne jugera que de la forme) et une procédure en révision restrictive. La surcharge de notre système judiciaire pourrait aussi amener les professionnels à plus facilement se reposer sur cet outil douteux. Si nous voulons nous protéger contre d’éventuelles erreurs judiciaires, nous ne pouvons qu’appeler à l’interdiction pure et simple du polygraphe dans nos procédures criminelles.
Pour continuer dans nos conclusions, il convient d’évoquer à nouveau la loi Salduz censée permettre un procès équitable en s’assurant notamment de la présence d’un avocat lors de l’audition par la police. Cette loi est une avancée pour les droits de la défense mais encore faut-il qu’elle soit correctement appliquée. On l’a vu, la Belgique a été condamnée en 2018 pour non-respect de ces dispositions. Depuis, la loi a encore été modifiée (notamment en 2024) à la demande de la Commission européenne qui avait évalué que « que certains points des directives législatives européennes n'ont pas été entièrement mis en œuvre par l'État belge ». Les violations constatées de la confidentialité des auditions entre le suspect et son avocat dans certains commissariats sont aussi un gros point d’attention. Quoi qu’il en soit, ces nouvelles dispositions et leur renforcement sont un point positif. Elles doivent nous protéger plus efficacement contre les erreurs judiciaires, surtout dans le cas de suspects vulnérables comme on l’a vu dans l’affaire Carlo V. ou Geert V. Cependant, quand on parle d’erreurs judiciaires, on l’évoque au présent – se prémunir aujourd’hui de nouvelles erreurs judiciaires - mais aussi au passé – reconnaître et réparer d’anciennes condamnations injustifiées. À ce niveau, qu’en est-il de toutes les personnes condamnées à de lourdes peines avant la loi Salduz et donc sur base d’auditions sans présence obligatoire d’un avocat ? S’y trouve-t-il des suspects vulnérables qui auraient avoué sous la contrainte sans la protection d’un avocat et sans que cela soit identifié par un juge ou des jurés lors du procès ? En clair, y a-t-il d’autres Carlo V. ou Geert V. dans nos prisons, et ces cas pourront-ils être identifiés et reconnus au travers de notre procédure en révision restrictive ? On ne peut répondre à cette question, mais cela rappelle l’importance de projets comme le Bénéfice du Doute qui agit sur le présent en médiatisant la problématique des erreurs judiciaires mais aussi sur le passé en aidant à identifier de potentiels innocents derrière les barreaux.
En guise de conclusion, il n’y a donc officiellement pas eu d’erreurs judiciaires en cour d’assises lors des dernières décennies en Belgique. Mais les ingrédients sont pourtant là, ou l’ont été (faux aveux, mauvaise gestion de suspects vulnérables, fausses accusations, recours massif au polygraphe ou techniques scientifiques trompeuses, droit à l’accès à un avocat pas toujours respecté, surcharge du système judiciaire…). Face à cela, pas de possibilité d’appel et une procédure en révision plus que cadenassée. Le tableau est préoccupant. Au-delà de nos recommandations ci-dessus, le Bénéfice du Doute apporte quelques solutions supplémentaires. Il faut former et sensibiliser les professionnels de la justice aux risques d’erreurs judiciaires. Il faut aussi fournir une aide aux condamnés se disant innocents et désirant demander une révision de leur procès. Le Bénéfice du Doute le fait déjà, mais vu l’échelle du projet et malgré son impact déjà notable, cela ne peut être qu’à la marge. Si l’État belge accepte que sa justice puisse être sujette aux erreurs, il doit investir les moyens nécessaires pour permettre de les identifier et les réparer. De manière générale, il faut réinvestir dans notre justice pour ne pas verser dans « l’État voyou » et réduire la surcharge de travail de nos juges. Ce n’est pas un luxe mais une condition pour une justice équitable et démocratique portant en son cœur le bénéfice du doute.
L'ensemble des éléments bibliographiques sont à retrouver dans la version .pdf de l'étude.
Nous publions une étude qui constate qu’il n’y a officiellement eu aucune erreur judiciaire en cours d’assises en Belgique depuis, a minima, 1995. Cela signifie-t-il que notre système judiciaire au niveau de la cour d’assises fonctionne parfaitement, sans aucun faux pas ? Plus précisément, la Belgique serait-elle immunisée contre les causes reconnues d’erreurs judiciaires à l’international ? Nos conclusions mettent en évidence le contraire. Cette étude se base notamment sur le travail du projet « Voordeel van de Twifel » (« Bénéfice du Doute ») lancé en 2021 à la Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Son objectif : analyser des dossiers de personnes condamnées pour des crimes en Belgique mais qui clament leur innocence derrière les barreaux. Pendant un an, des étudiants en criminologie, en droit ou en sciences biomédicales légales sont invités à étudier un dossier à charge afin d’en vérifier la solidité. Les erreurs judiciaires en cour d’assises semblent marquées par une forme de « tabou » sur le territoire belge. Une situation inquiétante qui, selon nous, appelle des réformes.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’étude sur les erreurs judiciaires.
Axel Winkel – auteur de l’étude, chercheur chez Citoyenneté & Participation : winkel@cpcp.be
TELECHARGER LA VERSION .PDF DES RECOMMANDATIONS
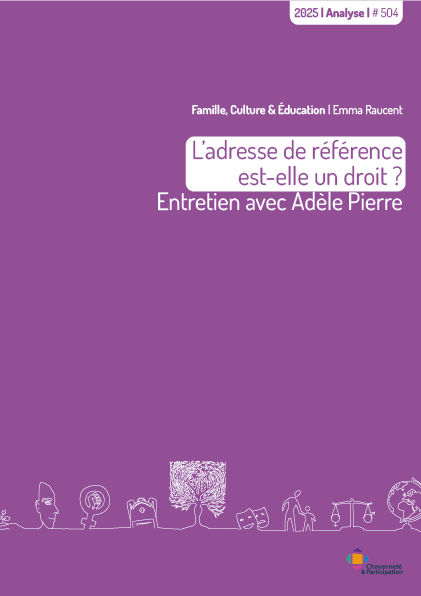

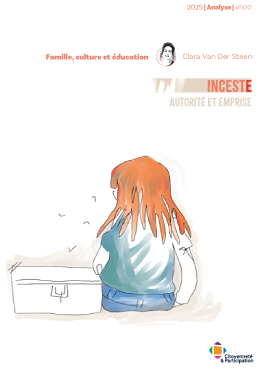
© 2025 Citoyenneté & Participation
Lire la suite de la publication
Politologue de formation, Axel Winkel est enseignant et chercheur chez Citoyenneté & Participation.