
Analyse n°504 de Emma Raucent - septembre 2025

Temps de lecture estimé : 20 min
En 2024-2025, nous sommes allés à la rencontre du secteur associatif de l'aide aux sans-chez-soi pour l'interroger sur sa réalité de terrain, ses besoins et ses aspirations. De ces rencontres sont ressortis de nombreux enjeux. L'article qui suit vous en présente un : l'accès aux droits par les personnes sans-chez-soi via le dispositif de l'adresse de référence.
Cet article donne un petit aperçu de la réalité du sans-abrisme et des logiques administratives et juridiques sensés l'encadrer et le faire diminuer. Il s'inscrit dans un projet plus large qui donne à voir les contours des violences institutionnelles propres à ce secteur.Un podcast en trois épisodes sortira tout bientôt pour restituer les éléments phares de nos rencontres avec le secteur et de ses préoccupations profondes.
(Emma Raucent, juin 2025)
L’existence administrative d’une personne, et donc son accès aux droits civils et sociaux, est conditionnée en Belgique à son inscription à une adresse, soit à l’enregistrement de son lieu de domiciliation. Comment les sans-chez-soi peuvent-ils dès lors prétendre à leurs droits et à la pleine jouissance de leur citoyenneté ? Pour pallier leur « inexistence administrative », un régime juridique d’exception a vu le jour en 1997 au terme d’un mouvement associatif et militant de revendications sociales en la matière. C’est le régime de l’adresse de référence. Encore peu étudié et appliqué de façon variable d’une commune et d’un CPAS à l’autre, ce régime constitue pourtant un mécanisme essentiel, bien qu’imparfait, dans l’accès aux droits par les personnes sans-chez-soi. Pour en cerner les contours et les enjeux, nous avons interrogé Adèle Pierre, chercheuse et conseillère auprès de Bruss’help. Dans le cadre du projet collectif de recherche MEASINB (Measuring Invisibility in Brussels) à l’UCLouvain, elle s’est penchée sur la question de la disparition des individus des registres et sur la conditionnalité des droits sociaux. Sa recherche, ancrée dans le terrain, a fait naître de nombreuses questions quant au bien-fondé du régime de l’adresse de référence et à son adéquation par rapport à la réalité des personnes sans-chez-soi.
La question fondamentale que je me suis posée est « pourquoi le registre national est-il si important ? ». Est-ce qu'il est aussi important en Belgique qu'ailleurs ? Les origines des registres de population datent avant tout de la Révolution française. On est alors dans une période de troubles et l’État républicain cherche à réinstaurer l'ordre au sein de la société française. Les élites instaurent de nouveaux outils de recensement et d’uniformisation pour gérer la population. Évidemment les registres ne sont pas une totale invention à l’époque mais proviennent des registres paroissiaux.
La volonté première, derrière cet outil, elle est avant tout sécuritaire. Ce n'est que par la suite, avec l'arrivée des États-providence, que ça va devenir aussi un outil d'accès à l'aide sociale. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir de 1900 le registre de la population sera abandonné en France. Par contre, sous l'égide du statisticien et démographe belge, Adolphe Quételet, la Belgique va perfectionner cet outil de contrôle de la population pour qu’il devienne le registre tel qu’on le connaît aujourd’hui. À l’heure actuelle, il est informatisé, mais ça reste exactement le même mode de fonctionnement. Y sont enregistrées des informations telles que la composition familiale, etc. En France, si on compare, ce n’est pas du tout la même chose. On peut prouver son identité en donnant une facture de gaz ou un permis de conduire. Le système de registre fondé sur la résidence, tel qu'il existe en Belgique, aussi abouti et aussi fin, est donc unique.
On sait que l'accès aux droits sociaux, comme le chômage, les allocations, etc., est conditionné, en Belgique en tout cas, à l’existence administrative de la personne. Dans les années 1990, apparaît donc l'adresse de référence au profit des personnes sans-chez-soi pour remédier à leur « inexistence administrative » due à leur absence d’adresse. Cet outil juridique existait depuis longtemps pour les marins, pour les militaires, pour les bateliers, pour toute personne qui par définition n'a pas d'adresse et qui a malgré tout besoin d'un ancrage administratif (dans leur cas, à la maison communale), un endroit pour continuer à recevoir son courrier. L’adresse de référence a donc été étendue aux personnes sans-chez-soi par une loi de 1997 [1]. Cette loi prévoit que le CPAS ou l’adresse d’une personne physique (avec son accord) peut devenir l’adresse de référence d’une personne sans-chez-soi. L’idée derrière cet outil est aussi de leur permettre de récupérer leur accès à la citoyenneté, puisque sans adresse, pas de droit de vote non plus, donc pas de participation au projet démocratique. C’est donc quand même une sacrée bataille qui a été gagnée en 1997.
En Belgique, la loi de Laurette Onkelinx de 1993, « contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire », abroge les dispositions pénales criminalisant le vagabondage et la mendicité. Elle introduit aussi la possibilité pour les pouvoirs publics de réquisitionner des bâtiments vides pour loger les sans-abris et leur donner ainsi accès au revenu d’intégration sociale. Toutefois, cette disposition n’est quasiment jamais activée par les communes. Ce blocage est alors le point de départ d’importantes actions militantes portées notamment par Alain Siénart [2] à travers sa « croisade des sans-abris » [3]. Après la tentative avortée d’un système de recensement des sans-abris dans un registre ad hoc, l’idée de l’adresse de référence germe à titre de revendication. Ce combat donne finalement lieu à l’adoption d’une loi en janvier 1997.
Si elle est défendue comme un droit par les mouvements issus de la société civile, l’adresse de référence n’est pas perçue comme telle par l’ensemble des parlementaires. Dans les travaux préparatoires de la loi, on voit de fait toute l’ambiguïté des motivations dans l’adoption d’un tel système. L’avant-propos, ayant en premier lieu égard aux droits civils, présente l’adresse de référence comme une condition à la jouissance de ces droits par les personnes ne bénéficiant pas de résidence. Certains parlementaires considèrent toutefois l’adresse de référence sous un autre angle : il s’agit plutôt là d’une obligation pour l’individu, celle d’être repérable et atteignable sur le territoire belge. D’autres encore excluent catégoriquement qu’il s’agisse d’un droit et insistent sur la nécessité que les CPAS gardent un pouvoir d’appréciation en la matière. Ce flou qui caractérise la nature même de cet outil juridique entraine, encore aujourd’hui, une insécurité juridique et sociale importante pour les sans-chez-soi, comme nous allons le voir dans la suite de cette interview.
L'objectif annoncé et affiché est de permettre aux personnes de recouvrir leur existence administrative et de récupérer leurs avantages sociaux. Mais pour moi il y a un 2e objectif, comme tu l'as mentionné, c'est le suivi de la personne, tant par le biais de l'administration que par des tiers éventuels, les forces de l'ordre, les huissiers de justice, etc. Ce sont souvent des personnes qui ont des dettes et donc l’adresse de référence permet aussi d'avoir un suivi de ces personnes-là. Et c'est là que le bât blesse. Pour moi, les pratiques d'octroi liées à l'adresse de référence diffèrent forcément d'un CPAS à l'autre du fait de ce double objectif. Il existe une législation qui pose un cadre normalement par rapport aux conditions d’octroi mais ce cadre est assez flou et autorise de très nombreuses interprétations.
Il y a trois conditions à vérifier. La première condition c'est la compétence territoriale du CPAS. Ça vaut pour tout type d'octroi de droits au CPAS. C'est plutôt absurde dans le cas de figure où justement la personne concernée n'a pas d'adresse. Les cas où le demandeur est hébergé à gauche à droite sont assez fréquents dans la situation d’errance, le dénombrement le montre très bien. Les sans-chez-soi sont très mobiles et donc vouloir vérifier une compétence territoriale dans ce cadre-là, c'est, comment dire, plutôt audacieux. Pour prouver la compétence territoriale, on va demander aux personnes de fournir des preuves. Ce qui peut s'avérer particulièrement difficile pour une personne sans domicile. On va par exemple demander aux personnes de fournir des tickets de caisse pour prouver que les achats se font sur le sol communal. Et pourtant, un extrait du tribunal du travail a donné gain de cause à une personne qui allait acheter son pain dans une boulangerie dans une autre commune, et a donc rejeté ce type de preuves.
La deuxième condition, c’est bien sûr le fait pour la personne d’être dans un état de besoin. La question centrale est de savoir si la personne a les ressources suffisantes ou non pour se loger. Ce critère est subjectif évidemment. Bien sûr cette subjectivité, elle est nécessaire pour s'adapter au contexte spécifique, propre à chacun. Le problème c’est qu’actuellement la libre appréciation des CPAS sur ce critère donne lieu à des pratiques contestables. Par exemple, dans le cadre d’un entretien auprès d’un CPAS, on a découvert qu’un assistant social demandait aux personnes d'enlever leurs chaussures et de montrer l'état de leurs chaussettes. C’est extrême et sans doute exceptionnel mais c’est un vrai retour du terrain. Par ailleurs, on a observé qu’aucun logiciel n’était utilisé pour évaluer les ressources de la personne qui demande une adresse de référence. Bien sûr, ces logiciels informatiques, comme l’outil en ligne REDI, dans lesquels les assistantes sociales encodent différentes informations sur la personne pour ajuster le niveau d’aide sociale octroyée, sont questionnables à beaucoup d’égards [4]. Mais le fait que la procédure d’octroi d’une adresse de référence ne passe pas par l’utilisation de ce genre d’outil et donc fasse exception pose question.
Et la 3e condition, c’est la radiation préalable de la personne des registres.
Sur la base de cette condition, paradoxalement, on s’assure que la personne a bien perdu tous ses droits, pour qu'elle puisse les récupérer ensuite. Quelqu'un qui risque de perdre son logement par exemple et qui veut se mettre en adresse de référence va devoir d'abord passer par une procédure de radiation. Donc on va « couper le robinet » de l'accès à tous les droits (sociaux) pour lui permettre de les récupérer ensuite. Je trouve cette condition particulièrement absurde. C'est une exigence qui n'apparaît pas dans la loi, mais seulement dans une circulaire de 2006 [5]. Et pourtant, malgré tout, ça reste une condition d'octroi de l'adresse de référence.
La loi a quand même créé un artefact qui va à l'encontre de la façon dont les registres fonctionnent. Normalement, c'est « adresse = droit » et là sans adresse de résidence, on va quand même accorder les droits via une fiction administrative. C'est un mécanisme intéressant mais qui a fait l'objet de peu de travaux. On retrouve quelques mentions dans certains rapports sur l'état de la pauvreté ou du sans-abrisme. Mais aucune donnée statistique n’est récoltée en la matière, donc il est impossible à l'heure actuelle de savoir combien d’adresses de référence ont été accordées dans l’ensemble de la Belgique. Les mécanismes de contrôle et de suivi pour l'adresse de référence diffèrent fortement d'un CPAS à l'autre.
Concernant les refus d’octroi injustifiés par exemple, c'est quelque chose qui remonte quand même souvent dans les entretiens menés avec des personnes sans-chez-soi. Mais pour pouvoir le dire officiellement, il faudrait mener des enquêtes. Il n’y a à ce stade pas suffisamment de données sur les refus d’octroi d'adresse de référence pour avoir une vue plus globale et objective.
Lorsqu’un refus d’octroi est contesté, l’affaire est portée en justice. Mais les juges se montrent plutôt stricts dans l’interprétation des critères, surtout celui lié aux ressources suffisantes. Par exemple, un Tribunal a estimé qu’une allocation de chômage de 1.103 EUR (en 2017) constitue un revenu suffisant pour trouver un logement et que le refus du CPAS d’octroyer une adresse de référence était donc justifiée [6].
Les Tribunaux ont également établi que toute personne en situation de séjour irrégulier (mais pas illégal) sur le territoire belge a droit à l’aide sociale, et donc à une adresse de référence. Dans le cadre d’une demande d’asile par exemple, la personne n’est en séjour illégal que lorsque sa demande a été rejetée et qu’un ordre de quitter le territoire lui a été notifié. Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, alors la personne a toujours droit à l’aide sociale [7]. En dehors du cas des demandeurs d’asile, le séjour illégal est défini sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [8].
Je pense qu’en toile de fond, la lutte contre la fraude sociale et contre la fraude au domicile est un facteur important. L’idée est donc de n’accorder ce droit qu’à titre exceptionnel, que quand la personne est dans une situation de précarité extrême. Parce que c’est clair que ce droit offre un certain avantage. Il est comme une cape d'invisibilité administrative. On ne sait pas où la personne se trouve. On sait juste que son adresse est au CPAS. On a observé du terrain des cas où des personnes parviennent à mettre des sociétés en adresse de référence. Ou des cas où les personnes qui vivent ensemble l’obtiennent pour éviter le statut de cohabitant et bénéficier du statut isolé. Cette fraude existe mais elle est plutôt rare. Une étude de 2018 de PEWC, mandatée par le SPP Intégration sociale, l’évalue à 4,5% de tous les bénéficiaires du CPAS [9]. Et puis il faut souligner que cette minorité n’est pas en situation de fraude sociale pour se payer des Ferrari mais juste pour essayer de vivre un peu plus dignement. On pense d’emblée que ces personnes vont frauder avant de considérer que ces personnes ont besoin d’aide. Ce qui est mis en place est davantage pour lutter contre une fraude qui reste minime.
Interrogé sur son adresse de référence, une personne sans-chez-soi en procédure de régularisation sur le territoire belge témoigne : « Je suis en procédure de régularisation 9bis [à titre humanitaire] et donc avoir une adresse de référence pour moi, c’est essentiel. J’en avais une auprès d’une personne qui me faisait payer 200 euros par mois pour la garder. Je n’avais pas le choix de payer. Mais il y a quelques semaines la personne a décidé de retirer mon nom sur la boîte aux lettres et a fait annuler mon inscription à son adresse. Je me retrouve donc maintenant sans rien, sans aucun lieu pour recevoir mon courrier, mes convocations, etc. » (témoignage anonyme)
Dans la pratique, les CPAS posent certaines conditions pour le maintien du droit. Le plus souvent, ils requièrent de la personne qu’elle se présente au CPAS tous les trois mois. Cette obligation ressort des travaux préparatoires de la loi [10]. Certains CPAS exigent même un relevé du courrier tous les mois. Selon moi, le délai d’un mois pose un peu question au regard de la situation administrative et sociale souvent fragile de la personne concernée. D’un autre côté, selon les échos de la police relevés dans notre enquête, des jugements ou des courriers très importants sont parfois envoyés à la personne, par exemple pour des convocations au tribunal ou au commissariat deux semaines à l’avance. Évidemment, ça pose problème si le courrier n’est relevé que tous les trois mois. La gestion du courrier requiert aussi beaucoup de travail de la part des CPAS.
L’adresse de référence est un dispositif temporaire qui est théoriquement soumis à une révision trimestrielle. Mais les outils de suivi manquent de clarté. Dans certains CPAS des dossiers d'adresse de référence sont clairement oubliés ou laissés de côté, et c'est entre autres ce qui explique que le nombre d’adresses de référence octroyées diffère fortement d’un CPAS à un autre. Il y a un turnover important parmi les travailleurs sociaux aux CPAS. Certains dossiers laissés sans suivi se retrouvent donc dans les mains d’un nouvel assistant social qui ne connait pas les individus concernés et n’est pas en mesure de gérer leurs situations. Aussi l’adresse de référence constitue une aide sociale à part entière qui n’est pas toujours associée à l’octroi d’un revenu d’intégration sociale. Elle ne représente donc pas nécessairement un enjeu financier pour le CPAS. Et dans le contexte de surcharge de travail qui caractérise souvent ce milieu institutionnel, les dossiers d’adresse de référence sont souvent remis en bas de la pile des priorités. D’un autre côté, il y a des CPAS où on enlève à la personne son adresse de référence sous prétexte qu’elle n’aurait pas cherché suffisamment activement un logement. Or ça c’est une pratique qui ne repose sur aucun texte légal.
Selon la règle, les CPAS octroient un revenu d’intégration à la condition que la personne demandeuse soit « disposée à travailler ». En d’autres termes, elle doit prouver qu’elle cherche activement un travail et le CPAS doit en contrepartie l’aider pour ce faire. Vis-à-vis d’une personne sans-chez-soi, cette exigence est en général particulièrement déconnectée de la réalité, des besoins et des ressources de cette personne. Cette condition peut être suspendue temporairement, selon l’appréciation du CPAS, si l’état de santé ou la situation spécifique de la personne ne lui permet pas d’y répondre. La situation de sans-chez-soirisme relève certainement d’une telle situation spécifique, ce qui est confirmé par la jurisprudence, mais elle n’est pas toujours acceptée par les CPAS.
Plus problématique encore est la situation où le CPAS refuse l’octroi d’une adresse de référence au motif que la personne ne rechercherait pas suffisamment un logement. Cette pratique, où l’adresse de référence devient un levier d’activation de la personne, est illégale. Elle est pourtant présente dans certains CPAS. Par exemple, le Tribunal du travail d’Anvers a été saisi d’une affaire concernant le refus d’un CPAS d’octroyer à une personne non seulement un RIS (revenu d’intégration sociale) sur la base de sa non-disposition à travailler mais également une adresse de référence, sur le constat d’une recherche insuffisante de logement. La personne concernée se retrouvait donc dans une impasse : trouver un emploi est difficile sans adresse, et trouver un logement sans la preuve d’un revenu est quasi impossible. Le Tribunal a dès lors tranché en faveur de l’octroi d’une adresse de référence temporaire tout en lui refusant l’accès à un revenu d’intégration le temps qu’elle prouve sa disposition au travail [11]. Cet arrêt illustre les logiques de l’activation et ses liens persistants avec le système de l’adresse de référence. Or, le fait pour la personne sans-chez-soi de bénéficier d’une adresse de référence ne la sort pas de la situation matérielle particulière qui justifie de suspendre la condition de la disposition au travail pour l’octroi d’un revenu d’intégration.
L’arsenal juridique qui encadre le système d’adresse de référence est assez complexe : la loi de 1997 complétant celle de 1991 sur les registres de la population, un arrêté d’exécution et plusieurs circulaires. En juillet 2023, a été mise en place une circulaire pour tenter de clarifier un peu plus ce régime qui donne lieu à des interprétations divergentes de la part des CPAS. L’idée derrière cette circulaire était donc de garantir que toutes les personnes sans-chez-soi bénéficient d'une réponse administrative uniforme et simplifiée en la matière. Dans la pratique, cet objectif ne semble pas vraiment atteint, en tout cas ça n'a pas été perçu comme tel par les assistants sociaux, et spécialement par les travailleurs sociaux des maisons d'accueil.
Ce qu’il faut retenir de cette circulaire, c’est la disposition qui étend aux sans-chez-soi l’obligation faite à toute personne de s’inscrire aux registres de la population à l’adresse où elle séjourne pendant plus de trois mois. Concrètement, si une personne sans-chez-soi réside dans une maison d’accueil (ou chez un particulier) pendant plus de trois mois, elle doit s’enregistrer auprès de la commune à cette adresse à titre de résidence principale. En deçà de trois mois, on revient au régime de l’adresse de référence. Donc ici d’une certaine manière, la circulaire cherche à revenir sur l’exception introduite par le régime de l’adresse de référence et à rétablir le principe du fonctionnement « normal » des registres de la population. La circulaire renoue avec la loi de 1991 qui établit l’obligation d’inscription de toute personne à une résidence principale pour un séjour de plus de trois mois en Belgique. Sauf que les personnes sans-abri ne sont pas du tout dans la même condition administrative que toute autre personne. Ici on a tenté de cadrer mais de cadrer sans comprendre. Ça voudrait dire que chaque fois que la personne sans-chez-soi change de refuge, ce qui est très souvent le cas, elle doit faire la démarche d’être radiée (perdant tous ses droits) et de se réinscrire à une nouvelle adresse, parfois auprès d’une nouvelle commune. L’adresse de référence, une fois obtenue, permet le maintien des droits, peu importe où la personne loge effectivement, alors qu’ici cette nouvelle obligation d’inscription à titre de résidence principale précarise fortement les sans-chez-soi d’un point de vue administratif.
Il faut aussi mentionner la difficulté de gestion que cette nouvelle obligation représente pour les maisons d'accueil. Elles se retrouvent en difficulté face à des personnes domiciliées à leur adresse qui ne payent pas leur loyer ou insécurisent les autres résidents ou le personnel. Les expulser devient beaucoup plus difficile, ce qui met encore plus en tension leur mission sociale d'accueillir une diversité de personnes et leur responsabilité de veiller au bien-être de la structure et au bien-être des résidents et de leur personnel. En conséquence, les maisons d’accueil pourraient durcir leurs conditions d’admission et se montrer moins ouvertes vis-à-vis des personnes les plus fragilisées.
Cette règle vaut aussi pour une résidence chez un particulier. Normalement, cette inscription ne remet pas en cause le statut de sans-abri de la personne et ne lui donne pas le statut de cohabitant (donc pas d'implication sur ses éventuels revenus de remplacement). Mais cette garantie n’est spécifiée que dans une FAQ sur le site Internet du SPP Intégration sociale à la suite d'une interpellation auprès du cabinet de la ministre Karine Lalieux par un groupe de travail dont je faisais partie. Je ne suis pas certaine que ça ait force de loi devant un tribunal…
Le 23 mai dernier, le Conseil d’Etat a annulé cette circulaire sur la base d’un vice de procédure [13]. Le Conseil n’a pas été saisi (alors qu’il aurait dû l’être) pour formuler un avis à propos de cette circulaire avant son adoption car elle revêtait un caractère normatif : elle s’appliquait à un nombre indéterminé de personnes (« toutes les personnes sans-abri ») et contenait des règles à portée générale (réglait la question de l’adresse de référence « de manière abstraite, pour le présent et l’avenir »). Cette annulation signifie entre autres que les sans-chez-soi ne devront plus se domicilier à la maison d’accueil où ils séjournent pendant plus de trois mois. Reste à voir comment le SPP intégration sociale réagira à cette annulation et si une nouvelle circulaire similaire sera lancée pour répondre aux manquements relevés plus haut.
Le cadre légal est très flou. Et les circulaires ne clarifient pas suffisamment bien ce cadre. À mon sens, il faudrait clarifier le principe de compétence territoriale. Parce qu’en l’état, il entraine des dénis de responsabilité et des allongements de procédures. La commune compétente pourrait par exemple être déterminée sur la base de la dernière adresse effective. Ou alternativement, si la personne se déplace ailleurs, le premier CPAS qui réceptionne la demande d'aide devrait être celui qui accorde automatiquement l’adresse de référence. Tout simplement parce que les personnes concernées s’adressent logiquement au CPAS qui est le plus proche d’elles.
Il faudrait également clarifier le principe de ressources insuffisantes. Pourquoi ne pas définir un montant de référence ou évaluer les ressources via un calcul et une enquête sociale qui s’appuient sur la situation particulière du demandeur ? Par exemple, est-ce qu'il a des dettes ? Quelle est sa situation familiale ? Est-ce qu'il doit verser une pension alimentaire ? Ce serait plus objectif et équitable.
Concernant la radiation préalable et la perte de droits associée, on pourrait instituer une période d'inscription minimum garantie où l'inscription aux registres serait maintenue malgré le fait que la personne n’ait plus de domicile et soit en attente d’une adresse de référence.
Une autre question qui se pose aussi c’est le niveau de pouvoir concerné. Selon moi, ça reste intéressant d'avoir quand même un contact local et un guichet accessible au niveau communal, mais certaines voix proposent d’instaurer des structures régionales dédiées aux personnes sans-abri. C’est aussi une voie de réflexion possible pour résoudre la problématique des différences de traitement en matière d’adresse de référence.
Ne pourrait-on pas également se détacher de l’idée de domiciliation pour mieux s’adapter à la situation des personnes qui vivent à la rue ? Par exemple, pourquoi ne pas inscrire une mention spéciale aux registres de la population pour la personne sans-abri indiquant où elle réside temporairement ? Ça maintiendrait les droits, ça assurerait le suivi du CPAS et ça permettrait de localiser la personne comme le recommande le SPF intérieur.
Effectivement, avec tout ça, on n’a même pas encore abordé la question fondamentale qui est la lutte contre le sans-abrisme. En matière d’accès aux droits, il y a un concept assez intéressant qu'on a approfondi en équipe, c'est celui du paradoxe postal. L'absence d'adresse des personnes sans-chez-soi entrave leur accès aux droits sociaux et inversement sans accès aux droits sociaux, ces personnes n'ont pas les revenus nécessaires pour se payer un logement. Pas de logement, pas d'adresse, pas de droit, pas de revenu. Cette image du triangle infini se prête très bien à la compréhension des mécanismes qui maintiennent les personnes sans-abri dans la condition d’extrême précarité. L'adresse de référence est quand même un des premiers éléments qui auraient pu apporter une réponse à ce paradoxe. Il y a aussi des nouveaux projets, comme les projets Rights First [14], qui peuvent aussi être intéressants.
Mais pour moi l’accès au logement est une priorité qui doit être envisagée même avant l'accès aux droits. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif principal, c’est-à-dire la sortie de la rue de ces personnes et leur garantir une situation stable. Les choses ne semblent pas aller en s’améliorant alors même que la Belgique est signataire de la Convention de Lisbonne qui prévoit la sortie du sans-abrisme d’ici à 2030. À Bruxelles, on s’est doté d’un master plan en 35 mesures pour y arriver [15]. La mesure 16 relève un manque criant de connaissances et de données sur le régime de l’adresse de référence. Elle affirme la nécessité de mener une vaste enquête statistique et qualitative en la matière qui sera normalement amorcée cet été. C’est la première étape avant de pouvoir produire des recommandations claires et officielles pour transformer le régime en un véritable outil de soutien aux sans-chez-soi et à leur sortie de la rue.
En l’état, l’adresse de référence semble plus relever d’un privilège que d’un véritable droit. En effet, le pouvoir d’appréciation et d’interprétation laissé aux CPAS semble éroder fortement la possibilité pour les sans-chez-soi d’y accéder sans entrave arbitraire. Les circulaires sont par ailleurs un mode « d’explication du droit » qui laisse à l’administration la possibilité de s’écarter de leur contenu. Elles n’ont donc pas force de loi au sens où elles ne peuvent être avancées à titre d’argument juridique devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Ceci alors même qu’elles ont parfois une portée normative, comme l’a pointé le Conseil d’Etat vis-à-vis de la circulaire de 2023. Un flou organisé semble donc régner.
Que l’accès à une citoyenneté pleine et entière puisse être accordé ou suspendu par une telle décision discrétionnaire alors même que les droits civils associés à cette citoyenneté sont en théorie inaliénables pose question. Si la jouissance des droits civils est en théorie indépendante de la fixation de l’individu dans l’espace, dans la pratique l’autorité publique ne les rend disponibles que dès lors qu’il peut se garantir, via une adresse, un lien juridique pérenne avec la personne et un contrôle sur ses modes d’intégration au sein de la société (voy. supra, arrêt du Tribunal d’Anvers).
Sur le fond, le fait que l’accès à l’adresse de référence soit subordonné à la radiation de la personne des registres et donc à la perte de tous ses droits, participe au maintien des sans-chez-soi dans une position de précarité et d’instabilité. Il arrive même que le courrier lié à la procédure de radiation, qui peut être longue, soit envoyé à l’adresse de la personne alors même qu’elle n’y vit justement plus [16]. Alors que d’autres mécanismes plus protecteurs seraient aisés à mettre en place, ce régime introduit ici un obstacle supplémentaire dans le parcours de la personne. S’il est censé garantir l’accès aux droits, sa mise en œuvre et l’instabilité qu’il entraine pour un public déjà particulièrement fragilisé posent donc une entrave structurelle à la sortie définitive de la rue.
Bibliographie
1 Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue d’imposer l’inscription aux registres de la population des personnes n’ayant pas de résidence en Belgique [en ligne]. 24 janvier 1997. [Consulté le 18 juin 2025]. Disponible à l’adresse :https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1997/01/24/1997000114/justel.
2 Ancien chauffeur à l’Orbem, et ancien SDF, Alain Siénart était le porteur de toute l’action lancée en 1994. Pour plus d’informations sur l’histoire de cette lutte, voy. : FRONT COMMON SDF. Notre histoire : la lutte des exclus de la société [en ligne]. 2013 1993. Disponible à l’adresse : https://frontsdf.be/files/histoire-du-Front-1.pdf.
3 PEETERS, Jean. Trop de CPAS contournent ou sabotent les adresses de référence [en ligne]. juin 2011. Disponible à l’adresse : http://www.asbl-csce.be/journal/Ensemble71pauvre6.
4 TEYSSANDIER, Anaïs. CPAS, are you «REDI» ? Alter Echos [en ligne]. 522e éd. Bruxelles : Alter Echos, 23 mars 2025. [Consulté le 16 juin 2025]. Disponible à l’adresse : [en ligne :] https://www.alterechos.be/cpas-are-you-redi.
5 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL INTÉRIEUR. Circulaire sans-abri. - c.p.a.s. competent adresse de reference. - inscription et radiation d’une inscription [en ligne]. Moniteur Belge, 4 octobre 2006. [Consulté le 16 juin 2025]. Disponible à l’adresse : [en ligne :] https://etaamb.openjustice.be/fr/document-du-04-octobre-2006_n2006023081.html.
6 PUYPE, F. Protection sociale des sans-abris. Revue belge de sécurité sociale. 2020, no 4.
7 C. trav. Liège (div. Namur), 29 juin 2023, R.G. 2022/AN/152.
8 Notion de séjour illégal. Dans : Terralaboris asbl [en ligne]. 31 janvier 2020. [Consulté le 11 juin 2025]. Disponible à l’adresse : [en ligne :] https://www.terralaboris.be/spip.php?rubrique4553.
9 PWC. Etude Fraude Sociale dans les CPAS - SPP Intégration Sociale [en ligne]. [S. l.] : [s. n.], décembre 2013. [Consulté le 16 juin 2025]. Disponible à l’adresse : [en ligne :] https://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/etude-fraude-sociale-dans-les-cpas
10 « L'inscription reste en principe valable tant que l'intéressé vient chercher sa correspondance à l'adresse de référence. Par contre, l'inscription expirera automatiquement si la personne inscrite ne vient plus chercher sa correspondance pendant une période de trois mois. » (Proposition de loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue d’imposer l’inscription aux registres de la population des personnes n’ayant pas de résidence en Belgique, Ch. rep., 1996-1997, 122/6, p. 10) ».
11 Trib. trav. Anvers 20 avril 2017, RG 16/6598/A.
12 Proposition de loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue d’imposer l’inscription aux registres de la population des personnes n’ayant pas de résidence en Belgique, amendements, Pub. L. No. 122/6 (1996), p. 7.
13 THOMAES-LODEFIER, Marie-Claire. Adresse de référence : le Conseil d’Etat annule la circulaire du 7 juillet 2023 ! Dans : uvcw.be [en ligne]. 6 juin 2025. [Consulté le 16 juin 2025]. Disponible à l’adresse : https://www.uvcw.be/aide-sociale/actus/art-9535.
14 D’HEYGERE, Steven. Le projet Rights First [en ligne]. [s. d.]. [Consulté le 4 juin 2025]. Disponible à l’adresse : https://www.brusshelp.org/index.php/fr/coordination/rights-first/2339-rights-first.
15 BRUSS’HELP. Le Masterplan de fin du sans-chez-soirisme [en ligne]. [S. l.] : [s. n.], 12 mars 2024. [Consulté le 16 juin 2025]. Disponible à l’adresse : https://www.brusshelp.org/index.php/fr/actus/projets/master-plan/2513-le-masterplan
16 ROBBEN, Laure-Lise, PIERRE, Adèle et HERMAN, Koen. ‘Without an address, you do not exist’: the administrative invisibility of people experiencing homelessness in Belgium. Citizenship Studies [en ligne]. 2023, Vol. 27, no 5, p. 566‑583. [Consulté le 16 juin 2025]. Disponible à l’adresse : https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:281462
TELECHARGER LA VERSION .PDF DE CETTE ANALYSE

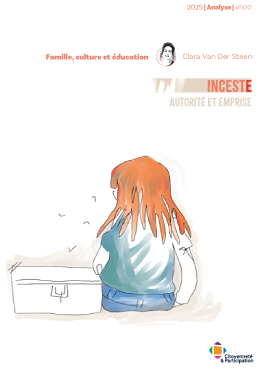

Lire la suite de la publication
Emma Raucent est titulaire d’un master en droit ainsi que d’un master de spécialisation en philosophie du droit. Elle est chargée de recherche dans la thématique Famille, Culture & Éducation, au sein du pôle Recherche & Plaidoyer chez Citoyenneté & Participation.